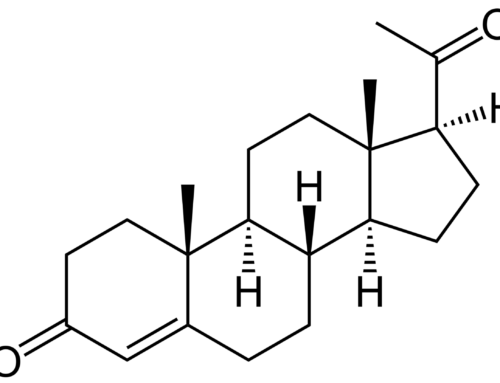Un petit préambule
On commence par un peu d’étymologie, et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci n’est pas franchement flatteuse pour notre ami à quatre pattes ! Furet vient du latin fur, qui signifie… voleur. Son nom d’espèce, putorius (puisqu’on en reparlera, le furet est un putois domestiqué) signifie : puant. Donc, le nom du furet dans la classification, Mustela putorius furo, nous informe que nous avons affaire à un voleur qui pue. Le verbe dérivé fureter fait référence à la curiosité de la bestiole, qui aime bien farfouiller dans les coins.
Un mot sur la classification : le Furet appartient sans surprise à la classe des MAMMIFERES et à l’Ordre des CARNIVORES. Il est de la famille des MUSTELIDAE, comme, entre autres, les loutres, martres, fouines et blaireaux, et du genre MUSTELA, comme les belettes, visons, hermines et putois – ce qui est logique, puisque le furet n’est jamais qu’un petit putois qui s’ignore. D’abord classé comme une espèce particulière par Linné, en 1758, sous le nom de Mustela furo, notre fufu a logiquement été ramené, un peu plus de deux siècles et quelques études génétiques plus tard, dans la même espèce que le putois, avec quand même une petite sous-espèce créée pour les différencier, ce qui nous donne le nom actuel de Mustela putorius furo.
A signaler qu’on trouvera plus d’informations sur le furet, notamment ses différentes variétés et quelques constantes biologiques, (espérance de vie, taille, poids, durée de gestation…), dans un autre chapitre de ce site consacré plus largement aux NAC.
De l’antiquité à la renaissance
Ceci étant posé, l’histoire : sans remonter jusqu’aux premiers mustélidés présents à l’Eocène ou au Miocène, le furet semble avoir été domestiqué à partir du putois (probablement le putois d’Europe (Mustela putorius) plutôt que le putois des plaines (Mustela eversmanni)), dans les 2000 à 3000 ans avant JC sur le pourtour méditerranéen, et utilisé notamment dans l’Egypte ancienne vers 1300 avant JC pour chasser les lapins et se débarrasser des rongeurs… mais ces informations sont quand même un peu floues, voire contestées, faute de peintures, sculptures ou fossiles en attestant. L’utilisation du furet est documentée de façon plus fiable dans la Grèce antique (Aristophane, Aristote…) entre les 5ème et 4ème siècle avant JC, puis à Rome, quelques écrits, (de Strabo, ou Pline l’ancien…), décrivant même des techniques de chasse proches de celles encore en vigueur de nos jours. Strabo relate notamment l’utilisation des furets par les Romains pour contrôler la surpopulation de lapins aux Baléares – les Néo-Zélandais n’ont donc rien inventé, on en parle un peu plus loin. Le furet profita ensuite des invasions romaines pour se répandre dans le reste de l’Europe, et peut-être de l’invasion des Normands en 1066 pour débarquer en Angleterre.
Une petite réserve tout de même sur ces premières descriptions, valable évidemment pour l’antiquité, mais même aussi pour la suite : on ne lui en tiendra pas rigueur, mais Aristophane n’avait pas eu vent des travaux de Linné, qui classa le furet domestique dans un genre séparé en 1758. Donc, quand on parle de furet dans l’antiquité, ou qu’on en lit seulement une description, bien difficile de savoir s’il s’agissait vraiment de furets, et non de putois, belettes, fouines, hermines, visons… il pouvait même arriver qu’un seul mot désigne toutes ces espèces à la fois !
Après les Grecs et les Romains, nous voici au Moyen-Âge, où la petite bête s’avère toujours aussi populaire pour la chasse, (ou furetage), mais aussi en tant qu’animal de compagnie. Enfin… pas pour tout le monde, il ne faut pas exagérer ! Le furetage était réservé aux nobles et possesseurs de terres (ou garennes), tandis que les furets (et certaines « hermines », qui pourraient bien, en fait, avoir été des furets), que l’on peut voir dans certains portraits de cour, étaient là pour souligner le raffinement, la pureté, voire la virginité de leur maîtresse, (ah, la blancheur du furet albinos !), ou le statut social, la richesse et la puissance de leur maître. (Ce n’est pas tout le monde qui se promène avec un prédateur sur l’épaule !)

Photo ci-dessus : La chasse au furet, sous Gaston Phœbus, (anonyme, 1387). Le monsieur en bas à gauche et celui au centre à droite introduisent chacun un furet dans un terrier pour en faire sortir les lapins, qui se font cueillir par les chiens ou se jettent tout droit dans les filets !

Ci-dessus à gauche : La dame à l’hermine, peinte par Léonard de Vinci en 1488. La dame en question s’appelait (probablement) Cécilia Gallerani, maîtresse du Duc de Milan, Ludovic Sforza. A droite : Le Portrait à l’hermine d’Elisabeth 1ère, peint par William Segar ou peut-être George Gower, (on n’est pas trop sûr), vers 1585. (Noter la petite couronne dorée autour du cou de la bestiole). Ci-contre : détail d’un portrait de Jean sans peur, réalisé par un peintre anonyme aux alentours de 1400-1425 : son petit furet est tendrement lové contre sa joue ! Bref, dans tous les cas, on n’est pas chez les manants. Dans la peinture de Léonard de Vinci, la taille de l’animal et son aptitude à garder sagement la pose laissent penser qu’il s’agissait d’un furet albinos plutôt que d’une véritable hermine.
Le Moyen-Âge touchant à sa fin, notre furet profite des grandes migrations humaines pour partir à la conquête du monde : c’est ainsi qu’on le retrouve sur les bateaux des explorateurs du XVème et XVIème siècles, en route pour les Amériques et autres terres lointaines, avec la lourde charge de débarrasser les navires de leurs rats et de leurs souris. Et puis on assiste à des introductions volontaires dans certains pays, qui vont parfois mal tourner : dans ce domaine, le cas de la Nouvelle-Zélande est particulièrement intéressant, et nous en parlons dans la deuxième partie, tout de suite en-dessous.
Le lapin et le furet : une fable bien amère
Quelques premiers lapins ont donc été importés, entre autres marchandises, d’abord en Australie, puis en Nouvelle-Zélande, dans les années 1840-1850. Certains ont bien réussi à s’échapper de leur clapier ou de leur enclos, et ont été vus gambadant deci delà, mais leur nombre restait limité. Et puis, malgré certains avis discordants, des libérations de lapins ont commencé à être organisées, parfois avec force discours, champagne et petits-fours, pour le plaisir de les chasser ensuite… ce qui n’était définitivement pas une bonne idée. Il ne fallut en effet que quelques années pour que les lapins ainsi libérés se multiplient et que les problèmes commencent. Dès le début des années 1870, les dommages causés aux pâturages, notamment par la présence des terriers, ont commencé à se faire sentir : les moutons, souffrant de malnutrition, ont vu leur population diminuer, avec pour conséquences une baisse du taux d’agnelages et, bien sûr, de la production de laine. A titre d’exemple, entre mars et juillet 1876, 26 000 lapins furent tués dans une seule propriété (de 4700 hectares, il est vrai), à l’aide de bêches, de chiens et d’un seul fusil : c’est dire s’il devait y en avoir !
C’est dans ce contexte que la décision fut prise d’importer des furets, « ennemis naturels des lapins » – et, on en parle moins, mais aussi des belettes et des hermines – au grand dam d’ornithologues s’inquiétant des conséquences de l’introduction de ces puissants prédateurs sur la faune locale, notamment les oiseaux. Mais bon, les plus impactés par les lapins étant les propriétaires des plus grandes exploitations, donc les plus influents politiquement, les ornithologues ne firent pas le poids. Des furets domestiques étaient déjà utilisés pour attraper les souris dans les maisons, et des furets « de travail » pour la chasse au lapin : on lâchait un furet (de préférence muselé) dans un terrier de lapin, ce dernier s’enfuyait, et il était cueilli à la sortie par les chiens de chasse ou le fusil du chasseur. Bon, tout ça c’était très bien pour attraper un lapin ou deux souris, mais quant à éliminer plusieurs centaines de milliers de lapins s’ébattant dans de vastes étendues de plaines et de montagnes parfois à peine explorées… c’était évidemment un peu juste : il allait donc falloir importer beaucoup, beaucoup, beaucoup de furets !
Le problème, c’est que le furet voyage mal, surtout quand la traversée sur un bateau à voile dure plusieurs mois, avec un « animalier » qui n’en a que le nom, et le virus de la maladie de Carré qui rôde, pour peu qu’un chien porteur soit passé par là. A titre d’exemple, sur deux cargaisons successives de 600 et 700 furets, il n’arriva que… deux survivants ! Des élevages de furets (croisés avec des putois pour mieux survivre à l’état sauvage), au demeurant très rentables pour leurs propriétaires, virent donc le jour sur place. Tout cela avait évidemment un coût, qui vint s’ajouter à celui des dégâts causés par les lapins. Car pendant ce temps-là, la prolifération continuait : en 1889, par exemple, 40 000 lapins furent tués en seulement deux mois dans la péninsule de Benmore.
Alors, avec une estimation de 75 000 furets élevés et lâchés dans la nature en 50 ans, comment expliquer que cette méthode de contrôle biologique n’ait pas permis d’empêcher la prolifération des lapins ? Parmi les raisons invoquées, outre des considérations ethnologiques sur les relations proies/prédateurs, et espèces locales/importées, il y a surtout le fait que la tâche était vraiment insurmontable pour les furets : les lapins vivent sur des territoires immenses, se reproduisent et courent plus vite que leur supposé prédateur, se cachent et s’échappent efficacement dans le dédale de leurs terriers, et sont même capables de se défendre ! Alors pourquoi un furet irait-il s’embêter à courir après un lapin, quand il est si facile d’attraper l’un de ces oiseaux locaux incapables de voler et qui, pour couronner le tout, construisent leur nid à même le sol ? Franchement… Et puis quand un furet a malgré tout réussi à attraper et manger un lapin ou une portée de lapereaux, il va faire la sieste jusqu’à ce que la faim le reprenne, pendant que le lapin, lui, continue à se reproduire ! Le seul moyen pour que ça marche aurait été de commencer à affaiblir la population de lapins pour que les furets n’aient plus qu’à terminer le travail, mais les tentatives de piégeages ou d’empoisonnements ont tué autant de furets que de lapins.
Kiwis et pingouins : deux victimes (parmi d’autres) de l’importation des furets en Nouvelle-Zélande.
En conclusion, un beau ratage, avec deux nuisibles au lieu d’un, (toujours autant de lapins, et une population de furets estimée en 2001 à un million d’individus), et de graves conséquences pour la faune locale : les furets ont, de façon certaine, joué un rôle dans le déclin, voire l’extinction de plusieurs espèces autochtones : essentiellement des oiseaux, comme le kiwi (qui est quand même l’emblème national), le Wéka, l’albatros royal, le canard bleu et le kākāpō (perroquet-hibou), mais aussi certaines espèces de pingouins, (ok, c’est aussi un oiseau), et de lézards. Certes, on ne peut pas juger les erreurs du passé avec nos yeux du XXIème siècle, on en savait alors beaucoup moins qu’aujourd’hui sur les dynamiques des populations et les relations entre proies et prédateurs, et il s’agissait là, après tout, d’une méthode de lutte biologique qui pourrait sembler tout ce qu’il y a de plus écologique… mais bon, des naturalistes avaient quand même alerté sur les dangers que constituaient ces introductions pour la faune locale, et les intérêts financiers et politiques avaient alors prévalu – comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas… Dommage collatéral pour les amis des furets : ces derniers ne sont pas franchement franchement interdits comme animaux de compagnie en Nouvelle-Zélande, mais une loi de 2002 interdit leur vente, diffusion et élevage… ce qui revient quand même à peu près au même. Les Australiens, forts de l’expérience de leurs voisins néo-zélandais, (ce n’est pas qu’ils n’aient pas voulu, eux aussi, introduire des furets au XIXe siècle, c’est juste que faute de les avoir croisés avec des putois, ils n’y sont pas arrivés ; et puis à la place, ils ont introduit la myxomatose, ce qui ne valait guère mieux), les Australiens, donc, ont déclaré la possession de furets illégale (y compris comme animal de compagnie), dans le Queensland et le Territoire du nord.
L’époque moderne
Depuis les années 1980, la première utilisation du furet est celle d’animal de compagnie, du fait de son caractère joueur et curieux, et de son intelligence. (Photos ci-dessous).On lit régulièrement que le furet se place au troisième rang des animaux de compagnie en France, (et plus largement en Europe), ainsi qu’aux Etats-Unis et au Japon. Selon les chiffres du Fichier National I-CAD, qui recense les identifications (aujourd’hui essentiellement par transpondeur = puce électronique), 923 329 chats, 713 812 chiens, et 2 233 furets ont été identifiés en France en 2024 ; (2 568 furets en 2023). En décembre 2024, en France, le nombre total de chats était estimé, par le ministère de l’agriculture, à 16,6 millions, contre 9,9 millions de chiens.



Un compagnon intelligent, joueur et curieux… mais qui demande de l’attention ! N’oublions pas que le verbe « fureter » dérive du mot « furet » !
Evaluer, de façon fiable, le nombre de furets semble, en revanche, beaucoup plus compliqué : certains sites (a priori sérieux), donnent le chiffre de 50 000… mais on lit ailleurs que 50 000 ne représenterait que le nombre de furets identifiés ! On trouve aussi les chiffres de 300 000 en 2010, et même, selon l’AFP, d’un million, la même année ! Si l’on prend le nombre total de petits mammifères présents dans les foyers français, toutes espèces confondues, on considère généralement qu’il est passé de 2,9 à 3,4 millions entre 2008 et 2016… sachant que d’autres sources citent le chiffre de 7,5 millions ! Sur ces 2,9, 3,4 ou 7,5 millions, le lapin représente 57% des ventes en animalerie, devant le cochon d’Inde, contre… 2% seulement pour les furets. Au vu de ces différentes estimations, et malgré leur caractère quelque peu contradictoire, on peut tout de même se demander si le furet est vraiment le troisième NAC présent dans les foyers français, devant le lapin de compagnie (population estimée entre 1 et 2 millions d’individus en 2025), ou le cochon d’Inde, par exemple. En tout cas, et même si l’on n’en parle jamais ou presque, n’oublions pas que chiens, chats et furets réunis arrivent très loin derrière nos plus de 33 millions de… poissons ! Mais ceci est une autre histoire.
La chasse, encore appelée, on l’a vu, furetage, déjà pratiquée dans la Grèse antique et peut-être même avant, reste encore de nos jours une autre utilisation du furet. Le chasseur (pardon, le fureteur) met à profit la capacité de la petite bête à s’insinuer à l’intérieur des terriers pour en faire sortir les lapins, et quand ceux-ci se présentent à la sortie, pan ! On leur tire dessus, ou bien on les attrape avec un filet. Le furet est généralement muselé pour éviter qu’il ne mange le lapin, au lieu de le pousser bien gentiment vers la sortie. Dans le même ordre d’idée, mais pas dans un but gastronomique, du moins on l’espère, le furet est aussi utilisé dans les jardins publics, les aéroports, les zones industrielles… pour rentrer dans les galeries et en déloger les rats et autres nuisibles.

Ce n’est pas une image de l’année, mais on retrouve sur cette gravure anonyme les mêmes techniques de chasse que du temps de Gaston Phœbus, comme on peut les voir sur la peinture figurant un peu plus haut dans cet article… techniques de chasse toujours en vigueur de nos jours !
Nettement moins glamour, le furet est aussi un animal de laboratoire apprécié, notamment pour l’étude des virus de la grippe et la mise au point de vaccins anti-grippaux ; et tout ça parce qu’il a la malchance d’avoir un appareil respiratoire très semblable à celui de l’Homme, et qu’en cas de grippe, il est l’un des rares mammifères à tousser, éternuer, et propager ainsi le virus par l’air… comme un humain ! Le furet a aussi été utilisé dans d’autres domaines de recherche : cardiologie, neurologie, toxicologie, etc.
Encore moins glamour, le furet a aussi été utilisé pour sa fourrure mais bizarrement, il nous a été difficile de trouver de la documentation sur le sujet. D’après le peu d’information disponible, il semble que cette fourrure ait été très appréciée au XIXe siècle, pour tomber en désuétude au milieu du XXe – son principal atout était sans doute d’être moins chère que la fourrure de vison ! On en trouve encore, malgré tout, sur des sites de vente en ligne, (de seconde main, mais aussi de neuf), sous forme de manteaux ou de cols en fourrure ; dans ce dernier cas, on a vraiment l’impression d’avoir un, voire deux vrais furets autour du cou, certes un peu aplatis, mais avec leur tête, leur queue et leurs pattes. Pour un peu, on s’attendrait presque à ce qu’ils se mettent à bouger ! Mais qui peut donc bien encore porter ça ?
De façon plus anecdotique, il existe des courses de furet, les lignes de la piste d’athlétisme étant ici remplacées par des tuyaux : le premier à sortir à l’autre bout de son tuyau a gagné !
D’un point de vue légal, les furets font partie des carnivores domestiques et sont, à ce titre, soumis aux mêmes obligations que les chiens et les chats. Ils doivent être obligatoirement identifiés par tatouage ou puce électronique, et la vaccination contre la rage est obligatoire pour toute sortie du territoire national.
Un petit rappel de la législation concernant les NAC appartenant à des espèces domestiques (les furets en font partie) : la détention des espèces listées dans l’arrêté du 11 août 2006 est libre. Les règles relatives à leur élevage sont stipulées dans l’arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques. Cet arrêté encadre les normes quant à leur hébergement ou encore tout ce qui est relatif à la gestion sanitaire. Par ailleurs, l’article L214-3 du Code rural et de la pêche maritime stipule qu’« Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Toute maltraitance animale est interdite et sanctionnée par la loi.
Et pour en revenir à l’utilisation du furet pour se faire des manteaux ou des écharpes, la loi du 30/11/2021 visant à lutter contre la maltraitance animale a mis fin aux élevages de visons d’Amérique et autres espèces sauvages élevées exclusivement pour leur fourrure : on peut penser que cela vaut aussi pour l’espèce domestique qu’est le furet !